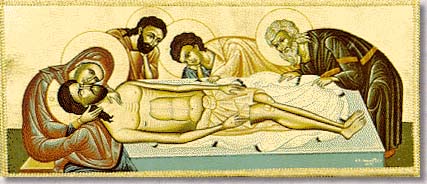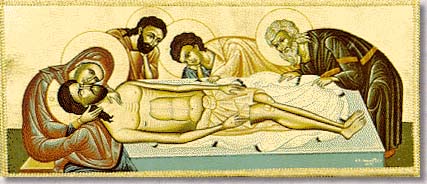|
Le Suaire de Turin
est une grande pièce de toile 437 cm de longueur et de 111 cm de largeur,
très anciennes et très particulière. On l'appelle "Linceul" ou "Suaire"
(en italien "Sindone", en anglais "Shroud") parce que, selon toute évidence,
cette toile a servi à envelopper un corps après la mort. Ce suaire est
très ancien.
Il est composé de
plusieurs morceaux. Le plus grand mesure 4,36 mètres sur 1 mètre, un
autre fait 4,36 mètres sur 9 centimètres et il a été rajouté avant 1357,
sans doute afin de rendre l'ensemble symétrique en recentrant l'image.
La face externe du Linceul a été doublée en 1534 par de la toile de
Hollande et 22 morceaux de toile d'autel ont servi à "colmater" les
traces de l'incendie de 1532. Le tissage est un sergé 3/1 à chevrons
en arêtes de poisson tel qu'il se pratiquait au Moyen-Orient au premier
siècle. Il a été tissé sur un métier à pédale de l'antiquité. Le lin
a été blanchi après son tissage alors qu'à partir du VIIIe siècle le
lin était blanchi avant d'être tissé.
On y voit les traces
de l'incendie de 1532, les brûlures rapiécées, les marques laissées
par l'eau, et d'autres trous résultant d'un incendie antérieur à 1192.
Tout le long de la marge qu'on indique conventionnellement comme marge
supérieure (on expose en effet le Saint Suaire avec l'empreinte antérieure
à gauche par rapport à ceux qui le regardent) on a cousu, il y a très
longtemps, une bande du même tissu que celui du Saint Suaire. On ignore
la raison de ce rapport de tissu, bien qu'on ait formulé de nombreuses
hypothèses à ce sujet. Au deux bouts, cette bande présente de nombreuses
lacunes, sous lesquelles on peut apercevoir le tissu de Hollande. Dans
ce cas aussi on ignore les circonstances et la raison de ces mutilations,
qui sont anciennes, sans aucun doute. Le long de la marge inférieure
de la lacune qui est située en haut à gauche par rapport à ceux qui
regardent le Saint Suaire se trouve la zone d'où on effectua les deux
prélèvements de tissu les plus récents: en 1973, pour des analyses sur
la typologie du tissu, et en 1978 pour la datation avec la méthode du
carbone 14.
Sur le Saint Suaire,
on peut remarquer quatre séries de brûlures de forme circulaire, elles
aussi avec une disposition symétrique, qu'il est impossible de faire
remonter aux dégâts occasionnés par l'incendie de Chambéry en 1532.
En effet, la disposition de ces brûlures, qui est différente par rapport
à celle des brûlures de Chambéry, renvoie à un autre système de pliage.
Ces brûlures sont sans aucun doute antérieures à l'incendie de 1532,
puisqu'elles sont déjà documentées par une copie picturale du Saint
Suaire réalisée en 1516 et actuellement conservée à Lierre, en Belgique.
Les lacunes n'ont pas été réparées, à la différence de ce qui a été
fait pour celles de Chambéry. Au-dessous de ces lacunes, en effet, on
aperçoit le tissu de Hollande sur lequel on a cousu le Saint Suaire
pour en renforcer la structure au cours de la "restauration" qu'on a
effectuée en 1534.
Dans la Sainte Chapelle
de Chambéry, le Saint Suaire était conservé replié dans une châsse en
argent. Une goutte de métal fondu qui a coulé sur le Linceul en a transpercé
tous les replis et a détruit le tissu. C'est ce qui explique la répétition
symétrique de ces lacunes en forme de triangle si caractéristiques.
Les deux lignes de brûlure noires qui courent sur les deux côtés de
la figure sont dues au contact avec la paroi surchauffée de la châsse.
Les lacunes ont été réparées par les Clarisses de Chambéry en 1534;
celles-ci ont cousu des rapiéçages, que l'on peut reconnaître grâce
à la couleur et à la trame du tissu, qui sont différentes par rapport
à celles du Saint Suaire. Le tissu autour des rapiéçages est plus sombre,
parce qu'il a été fortement roussi par la chaleur. Ce sont toujours
ces moniales qui ont cousu le Saint Suaire sur une toile de Hollande.
Au cours de l'incendie
de 1532, afin de pouvoir transporter la châsse et de mettre le Saint
Suaire à l'abri, il fut nécessaire d'utiliser de l'eau. Celle-ci pénétra
à l'intérieur de la châsse elle-même et mouilla la quasi-totalité du
Linceul. Les sept zones en forme de losange que l'on peut voir aujourd'hui
sur le Saint Suaire représentent en effet les quelques endroits qui
ont échappé à l'eau. Même dans ce cas, on voit que les traces sont répétées
à cause des replis du linceul. Le bord de la tache a une forme en zig-zag
à cause des substances qui se trouvaient sur le linceul et que l'eau
a transportées. La disposition des taches d'eau a fait supposer qu'il
y a eu plusieurs occasions où le Saint Suaire a été mouillé.
Sur ce tissu, on
distingue à peine l'image négative, jaune pâle, de la silhouette du
corps d'un homme nu dont la face et le dos sont opposés par le sommet
de la tête. Ses mains sont repliées sur son pubis. L'homme porte les
stigmates, traces rosées pâles aux contours distincts, de Jésus-Christ
tels qu'ils sont décrits dans les évangiles.
L'histoire supposée
du Linceul avant 1357
Sur plus de 13 siècles
d'histoire manquante,il serait illusoire de penser qu'un jour tous les
événements seront connus. Il restera donc toujours des incertitudes.
-
Les évangiles
canoniques:
-
Matthieu,
27 57-60 :
"Le
soir venu, il arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph,
qui s'était fait, lui aussi, disciple de Jésus.
Il alla trouver Pilate et demander le corps de Jésus.
Alors Pilate ordonna qu'on le lui remît.
Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre
et le plaça dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler
dans le roc ; puis il roula une grande pierre à l'entrée
du tombeau et s'en alla."
-
Marc,
15 42-46 :
"Déjà
le soir était venu et comme c'était la veille du sabbat, Joseph
d'Arimathie, membre notable du Conseil, qui attendait lui aussi
le Royaume de Dieu, s'en vint hardiment trouver Pilate et demanda
le corps de Jésus.
Pilate s'étonna qu'il fut déjà mort et, ayant fait appeler le
centurion, il lui demanda s'il était déjà mort.
Informé par le centurion, il octroya le corps à Joseph.
Celui-ci, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de
la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans
une tombe qui avait été taillée dans le roc ; puis il roula
une pierre à l'entrée du tombeau."
-
Luc,
23 50-54 :
"Survint
alors un membre du Conseil, nommé Joseph, homme droit et juste.
Celui-là ne s'était associé ni au dessein ni aux actes des autres.
Il était d'Arimathie, ville juive, et attendait le Royaume de
Dieu.
Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus.
Puis il le descendit de la croix, le roula dans un linceul
et le plaça dans une tombe taillée dans le roc, où personne
encore n'avait été mis.
C'était le jour de la Préparation, et déjà pointait le sabbat."
-
Jean,
19 38-42 :
"Après
cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais
en secret par crainte des juifs, demanda à Pilate l'autorisation
d'enlever le corps de Jésus.
Pilate le permit. Ils vinrent donc l'enlever.
Nicodème vint aussi ; c'est lui qui précédemment était
allé de nuit trouver Jésus.
Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ cent
livres.
Ils prirent le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes,
avec les aromates, selon la coutume funéraire juive.
A l'endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin et
dans ce jardin un tombeau neuf ; personne n'y avait encore
été mis."
-
A partir
des années 30 , il y aurait eu un portrait de Jésus
à Edesse ( Urfa en Turquie, près de la frontière syrienne ).
-
En 57,
il disparaît suite aux persécutions dont sont victimes les premiers
chrétiens.
-
En 340,
Saint-Cyrille de Jérusalem, dans ses Catéchèses, rapporte :
"...les témoins de la résurrection : la roche rouge veinée
de blanc et le Linceul."
-
Entre
525 et 544, au cours de travaux de reconstruction consécutifs
à une inondation, on retrouve ce qui sera appelé le Mandylion,
caché dans l'épaisseur d'un mur. Selon l'écrivain grec, Evagre
le Scholastique ( 527-600 ), ce voile "acheiropoïète",
"non fait de main d'homme", présente un portrait de Jésus.
-
En 639,
après la prise de la ville par les musulmans, il est transféré à
Constantinople.
-
En 726,
malgré l'occupation musulmane, sa présence à Edesse est de nouveau
signalée par Saint-Jean de Damascène.
-
Le 15
août 944, après le siège d'Edesse par l'empereur romain Lécapène,
le Mandylion est ramené en grande pompe à Constantinople à l'église
Sainte-Marie du Phare puis à Sainte-Marie des Blachernes, où il
sera exposé soit déplié soit replié dans un cadre ne laissant voir
que le visage.
-
La présence
du Linceul, qu'il soit assimilé ou non au Mandylion est rapportée
par plusieurs témoins.
-
Le 12
avril 1204, les croisés pillent Constantinople, le Mandylion
et/ou le Linceul disparaissent.
-
On retrouve
la trace du Linceul à Athènes de 1205 à 1207, où il aurait
été ramené par le duc Othon de la Roche.
-
Dérobé
lors du pillage de Constantinople en 1204 par la famille de la
Roche, il devient propriété de la famille de Charny.
Plusieurs hypothèses expliquent comment :
-
Soit
le duc d'Athènes, Othon de la Roche, l'a envoyé en 1208,
à son père, près de Besançon où au moins une copie aurait été
faite ( le fameux faux Linceul de Besançon qui sera détruit
en 1794 ).
En 1340, l'arrière-petite-fille d'Othon de la Roche,
Jeanne de Vergy, épouse Geoffroy Ier de Charny.
-
Soit
Geoffroy Ier de Charny en prend possession
au cours de l'un de ses voyages à Athènes.
-
Soit
par l'intermédiaire des Templiers.
La localisation
d'un Suaire, considéré comme le Linceul du Christ, est assurée à Constantinople
depuis 1080. Ian Wilson a proposé d'identifier le Suaire avec la célèbre
image d'Edesse, appelée "mandylion". Il s'agissait d'un linge reproduisant
le visage du Christ et conservé à Edesse. Le linge aurait été plié,
selon Wilson, de manière à ne laisser voir que le visage; à l'époque,
tout ce qui était cadavre était considéré comme impur, et l'on aurait
masqué les deux images du corps
-
En avril
1349, Geoffroy Ier de Charny écrit au pape
Clément VI pour lui faire part de son intention de construire l'église
Sainte-Marie de Lirey en hommage à la Sainte Trinité pour son évasion
alors qu'il était prisonnier des anglais. La collégiale sera achevée
en 1353. Geoffroy Ier de Charny meurt à la bataille
de Poitiers le 19 septembre 1356.
-
Sa veuve
organise les ostentions du Linceul entre 1357 et 1370 à Lirey,
ce qui lui procure des revenus conséquents.
-
En 1370,
l'évêque de Troyes, Henri de Poitiers interdit les ostentions sous
prétexte que le Linceul doit être faux puisque les évangiles n'en
font pas mention (?).
-
En 1389,
Jeanne de Vergy, qui entre-temps a épousé en secondes noces Aymon
de Genève, l'oncle du pape Clément VII, reçoit de ce dernier l'autorisation
de reprendre les ostentions.
Cela provoque la colère du nouvel évêque de Troyes, Pierre d'Arcis
tenu à l'écart. Il ordonne la cessation des ostentions mais le clergé
local refuse d'obtempérer et va même se plaindre auprès du pape
qui impose à l'évêque le "silence perpétuel" sous peine d'excommunication.
Pierre d'Arcis en appelle alors au roi Charles VI qui ordonne la
saisie du Linceul, mais le clergé de Lirey n'obtempère toujours
pas et poursuit même les ostentions.
En dernier ressort, l'évêque adresse au pape son fameux "Mémorandum
de Pierre d'Arcis" dans lequel il affirme que "ce
linge habilement peint sur lequel, par une adroite prestidigitation,
était représentée la double image d'un homme avait été fait pour
attirer les foules afin de leur extorquer habilement de l'argent".
Il affirme que son prédécesseur a enquêté et "qu'il a fini
par découvrir la fraude et comment le linge a été astucieusement
peint, la vérité étant attestée par l'artiste lui-même".
-
Le pape
Clément VII autorise néanmoins les ostentions publiques par sa bulle
du 6 janvier 1390 :
"...Enfin celui qui fera l'ostention devra
avertir le peuple au moment de la plus forte affluence et dire à
haute et intelligible voix, toute fraude cessant, que ladite figure
ou représentation n'est pas le vrai Linceul de Notre-Seigneur, mais
qu'elle n'est qu'une peinture ou un tableau du Linceul qu'on dit
avoir été celui du même Seigneur Jésus-Christ."
-
Pour
échapper aux ravages de la guerre de Cent Ans, les héritiers du
Linceul, les chanoines de Lirey, le confient à Marguerite de Charny
qui l'emmène à différents endroits jusqu'en 1453 à Genève.
Malgré les nombreux procès elle refusera toujours de rendre le Linceul.
Elle le vend alors à Anne de Lusignan, épouse du duc Louis Ier
de Savoie.
-
Les
ducs de Savoie conservent auprès d'eux le Linceul notamment dans
leur capitale Chambery où le Saint-Linceul apparaît officiellement
dans l'inventaire des reliques de la Sainte-Chapelle le 6 juin 1483.
-
En 1506,
le culte public du Linceul est approuvé de nouveau et reconnu comme
"unique linceul dans lequel Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même
fut enveloppé au tombeau" par la bulle du pape Jules II
du 26 avril.
-
De nombreuses
copies sont faites notamment le "Linceul de Lier" en 1516
dû à Van Orley.
-
Dans
la nuit du 3 au 4 décembre 1532, le Linceul est pris dans
le violent incendie qui ravage la chapelle où il est entreposé
dans un reliquaire d'argent dont l'une des parois commence à fondre.
Il sera copieusement arrosé pour sa sauvegarde et en conserve encore
de nos jours les traces.
-
En 1534,
sa restauration est confiée aux religieuses clarisses de Chambery
qui raccommodent la toile en cousant 22 pièces de tissu triangulaires
aux endroits des brûlures et le renforcent en le doublant par une
toile de Hollande.
-
De 1535
à 1561, il est déplacé au gré des conflits pour revenir à Chambery.
-
Le
16 septembre 1578, il est transporté à Turin, nouvelle capitale
de la Savoie.
-
Entre
1578 et 1720, les ostentions sont annuelles, le 4 mai.
-
Puis
les ostentions se font de plus en plus rares, il y en aura 5 au
XIXe siècle, en 1808, 1814, 1842, 1868 et enfin en
1898.
-
C'est
lors de cette dernière ostention, le 28 mai 1898, que l'avocat
italien, Secundo Pia, fut autorisé à prendre la première
photo du Linceul de Turin.
La photographie démontre que l'image du Linceul est une image
négative, ( concept moderne découvert
seulement au milieu du XIXe siècle suite à l'invention
de la photographie, incompatible avec les connaissances du moyen-âge ).
-
En 1900,
le chanoine Ulysse Chevalier, est le premier "à ouvrir le
bal" de la controverse, en publiant son "étude critique sur l'origine
du Saint-Linceul de Lirey-Chambery-Turin", favorable à la thèse
du faux, il s'appuie principalement sur le "Memorandum de Pierre
d'Arcis".
-
Le 21
avril 1902, le professeur d'anatomie, agnostique, Yves
Delage, expose à l'Académie des Sciences de Paris son étude
favorable à l'authenticité du Linceul.
-
Le 23
Mai 1931, à l'occasion d'une nouvelle ostention publique,
Guiseppe Enrie prend de nombreuses photographies du Linceul
en présence de Secundo Pia, âgé de 76 ans, et de scientifiques de
l'Académie Française.
Le Docteur Pierre Barbet conduit de nombreuses expérimentations
avec des cadavres pour reconstituer la Passion de Jésus telle qu'elle
apparaît sur le Linceul.
-
En 1937
la première Commision d'étude du Saint-Linceul est constituée.
-
En mai
1939 se tient le premier congrès national sur le Linceul à Turin.
-
En septembre
1939, le Linceul est secrètement déplacé dans l'abbaye de
Montevergine près de Naples où il reste jusqu'en 1946.
-
En 1950
se tient à Rome le Congrès International de Sindonologie.
-
En 1951,
création de la Guilde du Saint-Linceul.
-
En 1959,
création du Centre International de Sindonologie de Turin.
-
En 1960,
premières approches pour valider la faisabilité d'une datation au
carbone 14.
-
En 1969,
le Linceul est secrètement retiré de son coffre afin d'être étudié
par une équipe de scientifiques, sans aucun test direct. Giovanni
Battista Judica-Cordiglia prend la première photo couleur
du Linceul.
-
Le 1er
octobre 1972, un inconnu pénètre par effraction dans la chapelle
Royale pour tenter de mettre le feu au Linceul qui sera sauvé grâce
à sa protection en amiante.
-
En 1973,
le 23 novembre, le Linceul est exposé pour une retransmission à
la télévision.
Le 24 novembre, le Linceul est secrètement étudié par une nouvelle
commission d'experts qui effectuera 4 prélèvements directs de
tissu en périphérie du Linceul et 12 prélèvements de surface
à l'aide de ruban adhésif.
-
En février
1976, l'analyseur d'images VP 8 de la Nasa révèle la première
image tri-dimensionnelle du Linceul qui suscite un regain d'intérêt
de la part des scientifiques et aboutira à la création du STURP,
Shroud of TUrin Research Project.
-
En février 1979,
une demande officielle est faite auprès de l'archevêque Ballestrero,
gardien du Linceul, pour effectuer une datation au carbone 14.
En Mars, le STURP tient son premier "Atelier d'Analyse des Données",
au cours duquel seules les conclusions du Dr McCrone sont divergentes.
-
Le 18
mars 1983, décès de l'ex-roi Umberto II, propriétaire du
Linceul, qui appartient désormais au Vatican sous la condition
qu'il demeure à Turin.
-
En 1988,
après des années d'âpres négociations, le cardinal Ballestrero accepte
un protocole de datation au carbone 14, très éloigné du protocle
initialement prévu, avec seulement 3 laboratoires au lieu des 7
initialement proposés.
Avant même que les prélèvements soient effectués, la crédibilité
et la rigueur de cette étude sont mis en doute le 15 janvier
par les initiateurs du projet, les Pr Gove et Harbottle qui seront
écartés.
-
Le
21 avril 1988, le Linceul est secrètement retiré de son écrin
en présence du Dr Tite du British Museum, coordinateur du
projet, et des représentants des laboratoires de Zurich, de Tucson
et d'Oxford.
Le professeur Riggi effectue les prélèvements sous contrôle
vidéo mais ce dernier sera interrompu au moment où le cardinal Ballestrero
et le Dr Tite placeront les échantillons dans les éprouvettes métalliques
qui seront scellées de nouveau sous contrôle vidéo et remises à
chacun des représentants des laboratoires choisis.
Le professeur Riggi prélèvera pour son propre compte du sang sur
la partie dorsale du Linceul sur les plaies de la couronne d'épines,
ainsi qu'un morceau de tissu.
-
En août
et septembre 1988, des fuites permettent au "London Evening
Standard" et au "Sunday Times" d'annoncer qu'officiellement le Linceul
est un faux datant de 1350.
-
C'est
le 13 octobre 1988 que le cardinal Ballestrero tient sa conférence
de presse officielle au cours de laquelle il annonce le résultat
des tests situant l'âge du Linceul entre 1260 et 1390.
-
Le 16
février 1989, les résultats officiels de la datation au carbone
14 du Linceul sont publiés dans la revue Nature.
-
Le
24 mars 1989, on apprend que le laboratoire d'Oxford s'est
vu attribuer la somme fabuleuse d'un million de Livres par de riches
donateurs et le Pr Tite est nommé à la direction de la chaire scientifique
d'archéologie !
-
Un symposium
est organisé à Paris, réunissant des spécialistes de différentes
disciplines afin d'établir un bilan des études effectuées sur le
Linceul. Il aboutira à la création du Centre International d'Etude
sur le Linceul de Turin.
-
Le 18
septembre 1990, le cardinal Ballestrero qui était custode
à vie est destitué de ses fonctions par le pape Jean-Paul II et
remplacé par l'archevêque de Turin, Monseigneur Giovanni Saldarini
qui devient le nouveau Gardien du Linceul. Sans vouloir contredire
ouvertement son prédécesseur, il déclare :
"Il ne suffit pas d'affirmer que le drap est une pièce médiévale.
Le problème est de comprendre comment il est né".
-
Le 7
septembre 1992, 5 experts internationaux en textile peuvent
faire des observations optiques seulement, pas de prélèvements autorisés.
-
En 1993,
après avoir examiné l'échantillon de Riggi, plusieurs scientifiques
remettent en doute la datation au carbone 14 à cause du "vernis
Lichenothelia", un revêtement bioplastique qui aurait faussé la
mesure.
Le CIELT organise un symposium à Rome. L'ensemble de la communauté
scientifique internationale engagée dans les recherches, après notamment
une brillante démonstration du Dr Upinsky, proclame l'authenticité
du Linceul.
- Entre 1994 et
1996, l'Institut d'optique d'Orsay (A. Marion et A.-L. Courage) confirme
la présence d'inscriptions en grec et latin sur le Suaire (rien en
français du 13e s.).
-
-
Durant
la nuit du 11 au 12 avril 1997, un incendie criminel se déclare
dans la chapelle où est entreposé le Linceul qui sera sauvé des
flammes par l'action héroïque du pompier Mario Trematore.Le
CIELT organise un autre symposium à Nice. L'interrogation demeure
quant aux résultats de la datation au carbone 14.
-
En 1998,
du 18 avril au 14 juin, ostention publique du Linceul.
-
Ostention
publique du Linceul prévue du 26 août au 22 octobre 2000.
Arguments
contre l'authenticité du Linceul
- Jésus
n'a pas existé.
C'est
un problème historique toujours non résolu.
Dans ce cas, on peut se demander si, une fois de plus, les partisans
purs et durs de la pseudo-rationnalité ne jouent pas à "l'absence
de preuve est une preuve de l'absence !"
Il
est vrai qu'aucun des historiens du début de notre ère ( Flavius
Joseph, Juste de Tibériade, Philon... ) ne mentionnent
l'existence d'un personnage historique nommé Jésus.
Dans les temps troublés de la Palestine occupée, les faux messies,
les libérateurs du joug romain, les "résistants" pour les uns "terroristes"
pour les autres, étaient nombreux. Jésus, dont la vie publique n'a
pas dû excéder 3 ans, est sans doute passé inaperçu, sauf pour ceux
qui furent touchés par son message.
Il n'en
demeure pas moins que les 4 évangiles canoniques ( reconnus
officiellement par la papauté ) et la trentaine d'évangiles
apocryphes ( non reconnus ) existent bel et
bien en tant que documents historiques, et même s'ils contiennent
certaines contradictions, leur récit est globalement très similaire.
Reste
que les Manuscrits de la Mer Morte, dont seule une petite
partie de leur déchiffrement nous est connue, parlent du Maître
de Justice des Essénniens, qui pourrait fort bien être Jésus
le Nazaréen ou l'Essénien.
Pour
plus de précisions, voir l'ouvrage de Gerald Messadié, "L'Homme
qui devint Dieu" ( ed. Robert Laffont ).
- Un
texte de Pierre d'Arcis de 1389, adressé au pape Clément VII, dans
lequel il déclare que le Linceul de Lirey est un faux.
En 1389,
Jeanne de Vergy, l'héritière du Linceul de Lirey, qui a épousé en
secondes noces Aymon de Genève, l'oncle du pape Clément VII, reçoit
de ce dernier l'autorisation de reprendre les ostentions qui avaient
été interdites par l'évêque de Troyes, Henri de Poitiers ( pour
qui le linceul de Lirey est un faux car les évangiles n'en parlent
pas ).
Cela provoque la colère du nouvel évêque de Troyes, Pierre d'Arcis
tenu à l'écart. Il ordonne la cessation des ostentions mais le clergé
local refuse d'obtempérer et va même se plaindre auprès du pape
qui impose à l'évêque le "silence perpétuel" sous peine d'excommunication.
Pierre d'Arcis en appelle alors au roi Charles VI qui ordonne la
saisie du Linceul, mais le clergé de Lirey n'obtempère toujours
pas et poursuit même les ostentions.
En dernier ressort, l'évêque adresse au pape son fameux "Mémorandum
de Pierre d'Arcis" dans lequel il affirme que "ce
linge habilement peint sur lequel, par une adroite prestidigitation,
était représentée la double image d'un homme avait été fait pour
attirer les foules afin de leur extorquer habilement de l'argent".
Il affirme que son prédécesseur a enquêté et "qu'il a fini
par découvrir la fraude et comment le linge a été astucieusement
peint, la vérité étant attestée par l'artiste lui-même".
Ceci
constitue la seule assertion déclarant le Linceul comme un faux.
Il n'existe aucune trace ni de l'enquête de son prédécesseur ni
du soi-disant artiste faussaire qui l'aurait peint et encore moins
de la méthode utilisée.
Par ailleurs, ce manuscrit est unique, non daté et non signé.
Il existait
par contre de fortes rivalités entre le clergé iconoclaste et les
laïques qui exploitaient financièrement la foi des croyants.
- Un
léger défaut de proportion tête/corps.
Ce défaut
apparent disparaît si l'on admet cette position, qui cadre parfaitement
avec les dimensions du Linceul et qui montre à l'évidence que la
partie arrière est plus longue que la partie frontale.
Certains prétendent également que le nez serait trop long !
C'est un argument "assez court" pour un homme de type sémite dont
en plus le nez a été brisé.
- La
présence infime de pigments du moyen-âge.
Le Dr
Walter McCrone, criminologue et micro-analyste, a étudié les
32 prélèvements effectués en 1978 sur des rubans adhésifs. Il a
ainsi mis en évidence la présence infime de pigments d'oxyde
de fer rouge ocre et de sulfure de mercure vermillon,
ainsi que des protéines qui seraient issues d'un liant médiéval.
Pour
lui, l'affaire du Linceul est close, il s'agit d'une peinture du
moyen-âge !
Ses
résultats ont été contredits dès 1980 par d'autres scientifiques
comme par exemple John Heller et Alan Adler qui ont montré que les
éléments trouvés par McCrone étaient présents en quantité infinitésimale
et en divers endroits sans rapport avec l'image ou les tâches de
sang. Quand aux protéines, elles ne furent trouvées qu'aux emplacements
des tâches de sang.
Ce qui permet aux partisans de l'authenticité du Linceul d'affirmer
que ce n'est pas une peinture.
Malgré cela, les médias omettent systématiquement de signaler la
contradiction des travaux de McCrone, présentent le Linceul comme
un faux et n'expliquent aucune des caractéristiques de l'image du
Linceul. Décidément le mystère dérange et la science doit apparaître
toute-puissante et infaillible !
La
présence infinétisimale de pigments de couleurs peut fort bien s'expliquer
par le fait que de nombreux artistes au moyen-âge ont tenté de reproduire
le Linceul.
- La
datation au carbone 14.
Dès
1960 des scientifiques ont envisagé la datation au carbone 14 pour
le Linceul de Lirey-Chambéry-Turin.
La demande
officielle est faite en 1979.
En 1988, après des années d'âpres négociations, le cardinal
Ballestrero accepte un protocole de datation au carbone 14, très
éloigné du protocle initialement prévu, avec seulement 3 laboratoires
au lieu des 7 initialement proposés.
Avant même que les prélèvements soient effectués, la crédibilité
et la rigueur de cette étude sont mis en doute le 15 janvier
par les initiateurs du projet, les Pr Gove et Harbottle qui seront
écartés.
Le
21 avril 1988, le Linceul est secrètement retiré de son écrin
en présence du Dr Michael Tite du British Museum, coordinateur
du projet, et des représentants des laboratoires de Zurich, de Tucson
( Arizona ) et d'Oxford.
Le professeur Riggi effectue les prélèvements sous contrôle
vidéo mais ce dernier sera interrompu au moment où le cardinal Ballestrero
et le Dr Tite placeront les échantillons dans les éprouvettes métalliques
qui seront scellées de nouveau sous contrôle vidéo et remises à
chacun des représentants des 3 laboratoires choisis qui pratiquent
la Spectrométrie de Masse par Accélérateur ( technique
adaptée pour la mesure sur les petits échantillons ).
Les
mesures sont faites avec 3 échantillons témoins pour la procédure
en double aveugle comme le veut toute bonne recherche scientifique,
mais cette méthode ne sera pas employée !???.
Au lieu de cela, les échantillions sont identifiés et datés, du
IIe, XIe et XIIIe siècle.
En août
et septembre 1988, des fuites permettent au "London Evening
Standard" et au "Sunday Times" d'annoncer qu'officiellement le Linceul
est un faux datant de 1350.
C'est
le 13 octobre 1988 que le cardinal Ballestrero tient sa conférence
de presse officielle au cours de laquelle il annonce le résultat
des tests situant l'âge du Linceul entre 1260 et 1390
avec 95% de fiabilité.
Cette plage correspond en effet à l'apparition du Linceul en France.
Puis,
le British Museum organise sa confèrence de presse avec M. Tite,
coordinateur du projet, E. Hall, directeur du laboratoire d'Oxford
et R. Hedge.
Le Dr Tite déclare : "Je crois que le radio-carbone est la seule
certitude."
Le Dr Hall rajoute : "Quiconque possède une valeur scientifique
ne peut plus envisager que le suaire n'est pas un faux. Celui qui
pense le contraire pourra même s'entendre avec celui qui dit que
la Terre est plate."
Curieuse
déclaration du Dr Tite, qui croit plus en une mesure au radio-carbone
qu'à l'existence même de l'objet "mesuré" et qui passe sous silence
la manière dont cet objet unique aurait pu être fabriqué au moyen-âge !
Le 16
février 1989, les résultats officiels de la datation au carbone
14 du Linceul sont publiés dans la revue "Nature".
On apprend
le 25 mars 1989 que le laboratoire d'Oxford a reçu une récompense
d'un million de Livres pour avoir "prouvé" que le Linceul de Turin
était un faux médiéval !
De plus, le Dr Tite est nommé à la direction de la nouvelle chaire
scientifique d'archéologie ( récompense pour bons et loyaux services ? ).
Les
partisans du faux médiéval avaient marqué un point important qui
sema la confusion chez les convaincus de l'authenticité du Linceul.
Mais même si l'on admet exacte cette datation, cela ne répond à
aucune des autres interrogations que soulève le Linceul comme par
exemple l'apparition de l'image et sa non-reproductibilité. Depuis,
certains scientifiques ont mis en doute la datation.
Arguments
pour l'authenticité du Linceul >>>
Le linceul
(face - dos)
|